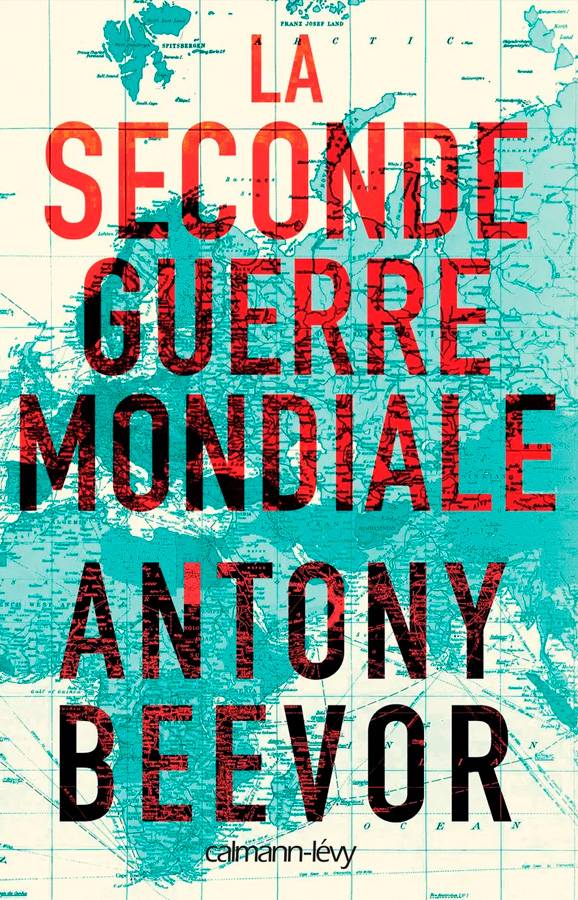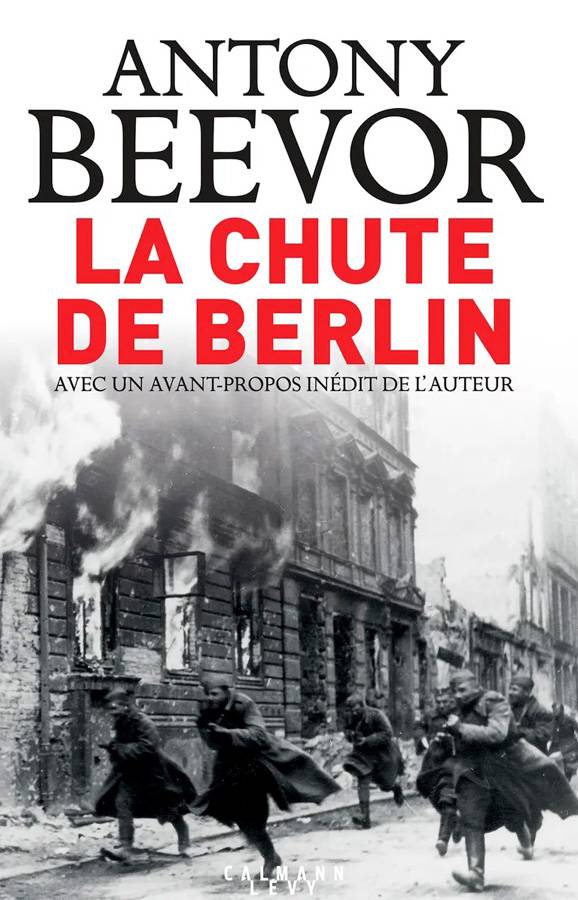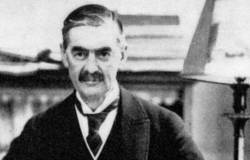Gueorgui Konstantinovitch Joukov
(1896–1974)
Fils de paysans et soldat de la révolution
Gueorgui Joukov naît le 1er décembre 1896 dans le petit village de Strelkovka, dans une famille de paysans pauvres. Très jeune, il est placé comme apprenti dans un atelier de maroquinerie à Moscou. La dureté du labeur forge son endurance, son caractère rugueux, sa discipline.
Il est mobilisé en 1915, pendant la Première Guerre mondiale, dans la cavalerie de l’armée impériale russe. Il se distingue rapidement au combat, est blessé et décoré de la Croix de Saint-Georges. Mais c’est la Révolution de 1917 qui marque un tournant décisif. En effet, Joukov rejoint les bolcheviks et devient officier dans la nouvelle Armée rouge.
Pendant la guerre civile russe, il combat avec acharnement contre les forces « blanches ». Il y gagne la réputation d’un commandant énergique, loyal au Parti, et impitoyable. Ce profil fera de lui un favori du régime stalinien dans les années 1930.
L’ascension dans l’Armée rouge
Alors que Staline purge l’armée de ses cadres supérieurs (plus de 30 000 officiers exécutés ou emprisonnés), Joukov, lui, survit. Il est en effet protégé par sa compétence tactique, sa loyauté sans faille, et son efficacité brutale. Ainsi, en 1939, il est nommé à la tête des forces soviétiques en Mongolie. Sa mission est alors de contrer les Japonais sur la frontière sino-soviétique.
Lors de la bataille de Khalkhin Gol, en 1939, il inflige une défaite cuisante aux troupes japonaises. Il s’agit d’ailleurs de la première grande victoire de l’Armée rouge moderne. Ce succès militaire, peu connu à l’Ouest, va peser lourd dans la décision japonaise de se tourner vers le Pacifique plutôt que de provoquer l’URSS.
En récompense, Joukov devient un héros national. Il est promu général, puis rapidement intégré au cœur du commandement soviétique à la veille de la Seconde Guerre mondiale.
L’homme du sursaut soviétique
Quand l’Allemagne attaque l’URSS le 22 juin 1941, lors de l’opération Barbarossa, l’Armée rouge est mal préparée, désorganisée par les purges, et subit revers sur revers. Staline, sous le choc, prend des décisions incohérentes. Au final, c’est Joukov que l’on appelle pour reprendre en main la défense.
En septembre 1941, il est chargé de la défense de Leningrad. Rapidement, il supervise celle de Moscou, que les Allemands menacent. Il organise une défense acharnée, planifie la première grande contre-offensive soviétique de la guerre en décembre 1941. Avec succès, puisqu’elle repousse la Wehrmacht à des dizaines de kilomètres. Ce premier échec allemand marque un tournant psychologique et stratégique.
Dur, autoritaire, exigeant, Joukov est craint de ses subordonnés mais respecté. Il n’hésite pas à sacrifier des dizaines de milliers d’hommes pour tenir une position ou percer une ligne. Pour lui, la victoire justifie tout.
Stalingrad, Koursk, et la reconquête
En 1942, il est l’architecte de la stratégie soviétique sur tout le front. C’est lui qui coordonne la contre-offensive de Stalingrad (opération Uranus), en novembre 1942. Il encercle la 6e armée allemande du général Paulus, qui se rend en février 1943 : l’URSS vient de remporter la plus grande bataille de la guerre moderne.
Quelques mois plus tard, c’est encore Joukov qui supervise la victoire de Koursk, en juillet 1943, où l’Armée rouge écrase les forces blindées allemandes. Cette bataille – la plus vaste bataille de chars de l’Histoire – marque la fin des espoirs allemands à l’Est.

Wostok Press-MAXPPP
Dès lors, Joukov mène la grande reconquête. Ainsi, il coordonne l’offensive de Biélorussie, les libérations de Minsk, Varsovie, puis de la Pologne entière. Il avance inexorablement vers l’Allemagne, commandant des millions d’hommes, imposant sa méthode : puissance de feu massive, écrasement, et sacrifice si nécessaire.
La chute de Berlin
En avril 1945, c’est à Joukov que Staline confie la prise de Berlin, objectif politique et symbolique majeur. Il dirige l’offensive finale, traversant l’Oder sous un feu nourri, engageant les combats de rue les plus violents de la guerre.
Après de terribles affrontements, Berlin tombe. Le 2 mai 1945, les troupes de Joukov hissent le drapeau rouge sur le Reichstag. Quelques jours plus tard, l’Allemagne capitule. Le 8 mai 1945, c’est Joukov qui signe la capitulation allemande à Berlin, au nom de l’Union soviétique.
Il devient alors le symbole vivant de la victoire soviétique : héros populaire, maréchal vénéré, célébré comme le libérateur de l’Europe de l’Est, l’homme qui a terrassé la Wehrmacht.
L’ombre de Staline
Cependant, dans les cercles du pouvoir soviétique, cette popularité inquiète. En effet, Staline, paranoïaque, craint les figures trop aimées. Il relègue Joukov à des fonctions subalternes, le tient à distance et le prive de tout rôle politique réel.
Après la mort de Staline en 1953, Joukov retrouve brièvement les faveurs du régime. Ainsi, il est nommé ministre de la Défense sous Khrouchtchev. Il modernise alors l’armée et participe à la répression de l’insurrection hongroise en 1956. Toutefois, il est à nouveau écarté en 1957, accusé de chercher à s’imposer politiquement.
Retiré de la vie publique, il se consacre à l’écriture de ses mémoires, publiées sous la surveillance du Parti, et devient une figure respectée mais muselée. Il meurt à Moscou le 18 juin 1974, à 77 ans. Ses funérailles attirent des foules immenses.
Joukov en quelques questions
Joukov a été l’architecte de presque toutes les grandes victoires soviétiques : la défense de Moscou, la contre-offensive de Stalingrad, la bataille de Koursk et la prise de Berlin. Son génie résidait dans sa capacité à coordonner d’immenses masses de blindés, d’artillerie et d’infanterie avec une précision logistique implacable.
C’était une relation de respect mutuel teinté de peur et de méfiance. Joukov était l’un des rares à oser contredire Staline en face sur des questions militaires. Staline avait besoin de lui pour gagner la guerre, mais dès 1946, il l’a écarté du pouvoir, craignant que le prestige du Maréchal ne menace son propre culte de la personnalité.
Cette expression désigne la méthode de Joukov consistant à concentrer une supériorité numérique et matérielle écrasante sur un point précis du front pour briser les lignes ennemies. Une fois la brèche faite, il lançait ses armées blindées en profondeur pour encercler l’adversaire, sans se soucier du nombre de victimes russes.
Commandant du 1er front de Biélorussie, c’est lui qui a dirigé l’assaut final sur la capitale du Reich. Il a mené la course contre son rival, le maréchal Koniev, pour offrir la victoire à Staline. C’est également Joukov qui a présidé la signature de la capitulation allemande à Berlin le 8 mai 1945.
Après la mort de Staline, il a brièvement retrouvé le pouvoir en devenant ministre de la Défense, jouant un rôle clé dans l’élimination de Beria. Cependant, il fut de nouveau écarté par Khrouchtchev en 1957, qui s’inquiétait de son influence sur l’armée. Il a terminé sa vie en écrivant ses mémoires, restant une icône absolue pour le peuple russe.