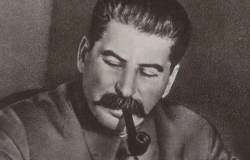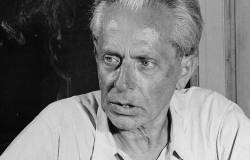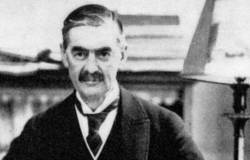Franklin D. Roosevelt
(1882–1945)


Un héritier patricien
Franklin Delano Roosevelt naît le 30 janvier 1882 dans la vallée de l’Hudson, dans l’État de New York. Issu d’une famille patricienne, riche et influente, il grandit dans un environnement de privilèges et de traditions. Cousin lointain de Theodore Roosevelt, ancien président républicain, il est bercé par les valeurs de service public et de responsabilité sociale.
Franklin étudie à Harvard, puis à Columbia, avant de se tourner vers la politique, dans le camp démocrate. Il se marie à sa cousine éloignée, Eleanor Roosevelt, figure majeure du féminisme et de l’humanisme américain. Il entame ensuite une ascension politique progressive, qui sera brutalement interrompue par une tragédie personnelle.
L’homme debout malgré la polio
En effet, en 1921, à 39 ans, Roosevelt est frappé par la polio. Cette maladie le laisse paralysé des jambes à vie. Mais il refuse de se retirer. Surtout, à force de volonté, il apprend à se tenir debout à l’aide de béquilles ou d’un support, et à dissimuler son handicap en public. De plus, il fonde un centre de rééducation à Warm Springs, en Géorgie. Au final, il transforme cette épreuve en symbole de courage et de ténacité.

Cette maladie marque profondément sa psychologie. Elle nourrit son empathie, renforce sa détermination, forge son image de combattant calme mais inflexible, capable de tenir debout même face à l’adversité la plus cruelle.
Le sauveur de l’Amérique en crise
Élu gouverneur de New York, puis président des États-Unis en 1932, au cœur de la Grande Dépression, Roosevelt devient le chantre du New Deal, une série de réformes sociales, économiques et financières destinées à relever un pays effondré. Il s’attaque aux banques, crée des emplois publics, protège les travailleurs, régule le marché.
Il est le seul président américain à avoir été élu quatre fois, en 1932, 1936, 1940 et 1944. Son style est unique : chaleureux, accessible, il s’adresse régulièrement à la nation par radio dans ses « causeries au coin du feu », instaurant une relation directe avec les citoyens. Charismatique, souriant, habile communicant, Roosevelt devient le visage d’une démocratie en renaissance, au moment même où les dictatures s’imposent en Europe.
Le spectateur vigilant
Quand la Seconde Guerre mondiale éclate en 1939, Roosevelt choisit de maintenir la neutralité américaine, en adéquation avec l’opinion publique, encore marquée par les traumatismes de 1914-1918. Mais il ne reste pas inactif. Hostile au nazisme dès le début, il manœuvre pour soutenir discrètement les britanniques.

Il fait voter la loi « Cash and Carry », puis en mars 1941, la Lend-Lease Act, qui permet aux États-Unis de fournir armes, vivres et équipements au Royaume-Uni, à l’URSS et à la Chine sans entrer officiellement en guerre. Roosevelt joue un double jeu subtil : officiellement pacifiste, officieusement moteur du soutien aux démocraties assiégées.
Il correspond personnellement avec Churchill, avec qui il développe une relation de confiance et de respect, mais aussi avec Staline, dans une tentative constante de maintenir l’unité du camp allié.
Pearl Harbor et l’entrée en guerre
Le 7 décembre 1941, l’attaque japonaise sur Pearl Harbor, à Hawaï, provoque un choc national. Roosevelt réagit immédiatement. Le lendemain, dans un discours historique au Congrès, il qualifie cette date de « jour d’infamie », et déclare la guerre au Japon. Quelques jours plus tard, l’Allemagne et l’Italie déclarent à leur tour la guerre aux États-Unis : l’Amérique entre pleinement dans le second conflit mondial.
Roosevelt devient alors le chef de guerre d’une superpuissance industrielle et militaire. Il supervise la mobilisation de millions d’hommes, la conversion de l’économie à la production d’armement, la coordination des fronts Pacifique et Atlantique. Il choisit Eisenhower pour diriger les forces alliées en Europe, mais reste personnellement impliqué dans les grandes orientations.
Diplomatie et vision mondiale
Roosevelt ne pense pas seulement en termes militaires. Il anticipe l’après-guerre, imagine un nouvel ordre mondial fondé sur la coopération entre grandes puissances, la fin des empires coloniaux, et la prééminence des Nations unies. Dès 1941, avec Churchill, il signe la Charte de l’Atlantique, esquisse d’un monde libéré de la tyrannie.

En 1943 à Téhéran, puis en 1945 à Yalta, il rencontre ses deux alliés, Churchill et Staline. Il cherche à maintenir l’unité fragile entre les démocraties libérales et l’URSS, conscient que la guerre froide menace déjà. Sa santé décline, mais il continue à œuvrer pour une paix durable. Son espoir : que les États-Unis, l’URSS, la Grande-Bretagne et la Chine deviennent les piliers d’une gouvernance mondiale stabilisée.
Un homme affaibli, mais debout jusqu’à la fin
Miné par les années de guerre, par une tension physique et mentale permanente, Roosevelt apparaît amaigri et vieilli à Yalta. Il cache son épuisement autant que possible, mais ses proches savent que la fin est proche. Le 12 avril 1945, à Warm Springs, il meurt d’une hémorragie cérébrale, moins d’un mois avant la capitulation de l’Allemagne.
Sa disparition plonge l’Amérique dans le deuil. Il laisse la présidence à son vice-président Harry Truman, un homme peu préparé à porter soudainement de telles responsabilités. Roosevelt ne verra ni la chute de Berlin, ni Hiroshima, ni la naissance officielle de l’ONU. Mais son empreinte est immense.
Franklin D. Roosevelt en quelques questions
Atteint de la poliomyélite en 1921, Roosevelt a perdu l’usage de ses jambes. Durant tout son mandat, il a fait preuve d’une discipline de fer pour cacher son fauteuil roulant au public, s’appuyant sur des attelles métalliques ou sur le bras d’un proche pour donner l’illusion qu’il se tenait debout, afin de projeter une image de force et de stabilité.
Lancé en mars 1941, ce programme a permis aux États-Unis de fournir d’immenses quantités de matériel de guerre (avions, tanks, munitions, nourriture) au Royaume-Uni, à l’URSS et à la Chine avant même leur entrée officielle en guerre. Roosevelt décrivait cette aide comme « prêter un tuyau d’arrosage au voisin dont la maison brûle ».
Il est le seul président américain à avoir accompli plus de deux mandats. Sa popularité immense reposait sur sa gestion de la Grande Dépression (via le New Deal) et sur sa stature de chef de guerre. Après sa mort en 1945, la Constitution a été modifiée pour limiter la présidence à deux mandats.
Bien qu’ils soient devenus des amis proches et des alliés indéfectibles, leur relation était complexe. Roosevelt était souvent plus pragmatique vis-à-vis de Staline et se montrait critique envers l’empire colonial britannique, ce qui créait parfois des tensions lors des grandes conférences comme Yalta ou Téhéran.
Malheureusement non. Épuisé par la maladie et les responsabilités, il est décédé d’une hémorragie cérébrale le 12 avril 1945, à peine quelques semaines avant la capitulation de l’Allemagne (8 mai) et quelques mois avant celle du Japon. C’est son vice-président, Harry Truman, qui a terminé le conflit.