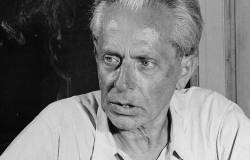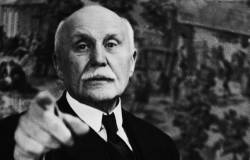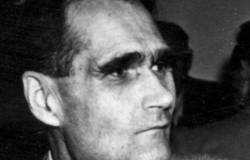Hideki Tojo
(1884–1948)
Un officier né dans l’ombre de l’empire
Hideki Tojo naît le 30 décembre 1884 à Tokyo, dans une famille de samouraïs reconvertis dans la carrière militaire. Son père, officier de l’armée impériale, transmet à son fils la discipline militaire, la fidélité à l’empereur, et le sens du devoir absolu envers l’État.
Éduqué dans une ambiance fortement nationaliste et militariste, Tojo entre à l’académie militaire impériale, puis à l’école supérieure de guerre. Il s’y distingue par sa rigueur, son application, et son attachement strict aux hiérarchies. Ce n’est pas un génie militaire, mais un organisateur méthodique, un homme de dossiers et d’exécution, implacable dans ses convictions.
Le militant du militarisme japonais
Au fil de sa carrière, Tojo s’impose comme un ultranationaliste rigide. En effet, il est convaincu que le Japon doit devenir la puissance dominante d’Asie. Ainsi, dans les années 1920 et 1930, il adhère aux cercles militaristes, qui prônent l’expansion impériale, la lutte contre l’Occident et la purification morale de la société japonaise.
Par la suite, en 1937, il devient chef d’état-major de l’armée du Kwantung en Mandchourie, région chinoise que le Japon a envahie en 1931. Il y supervise une politique de répression brutale, d’expansion militaire, et de colonisation économique, mêlant exactions, travaux forcés et massacres.
Lorsque la Seconde Guerre sino-japonaise éclate en 1937, Tojo est nommé vice-ministre de la Guerre, puis ministre en 1940. À ce poste, il soutient l’axe Rome-Berlin-Tokyo, renforce la mainmise de l’armée sur le gouvernement, et pousse le Japon vers l’affrontement avec les puissances occidentales.
Le Premier ministre de la guerre
Le 17 octobre 1941, en pleine crise diplomatique avec les États-Unis, l’empereur Hirohito nomme Tojo Premier ministre. Il cumule ce poste avec ceux de ministre de la Guerre, de l’Intérieur, et de président du Conseil de Défense impérial. Il devient l’homme le plus puissant du Japon, incarnation du militarisme d’État, et maître d’œuvre de l’entrée en guerre.
Tojo estime que les négociations avec Washington sont vouées à l’échec, que l’embargo pétrolier américain condamne le Japon à étouffer, et que la seule voie est la guerre préventive. Il approuve donc le plan d’attaque de Pearl Harbor, déclenchée le 7 décembre 1941, qui fera basculer les États-Unis dans la guerre.
Ce jour-là, Tojo pense frapper un coup décisif. Mais il sous-estime gravement la puissance industrielle américaine, et surestime la résilience japonaise. Le conflit qui s’engage sera meurtrier, long, et sans issue pour le Japon impérial.

Gamma-Keystone
L’homme fort du Japon en guerre
Pendant trois ans, Tojo dirige l’effort de guerre. Il centralise tous les pouvoirs, gouverne sans contre-pouvoirs civils, contrôle la presse, les tribunaux, la censure. Il mène une politique de mobilisation totale, de sacrifice national, exaltant l’esprit de bushido, la loyauté aveugle à l’empereur, et le refus absolu de la reddition.
Sous son autorité, les forces japonaises s’étendent sur tout le Pacifique : Philippines, Indonésie, Birmanie, Indochine, Malaisie… Mais cette expansion territoriale se double de violences massives : massacres de civils, viols de masse (comme à Nankin), exploitation forcée de travailleurs, usage des « femmes de réconfort », exécutions de prisonniers, travaux forcés sur la « voie ferrée de la mort ».
Tojo cautionne et encourage ces pratiques, considérées après-guerre comme des crimes de guerre systématiques.
La défaite et la chute
À partir de 1942, après les défaites de Midway, de Guadalcanal et en Nouvelle-Guinée, l’offensive japonaise s’enlise. L’aviation et la marine américaines prennent l’ascendant, tandis que l’économie nippone s’épuise. Le rêve de Tojo s’effondre, mais il refuse toute concession, prônant le combat jusqu’à la mort.
En juillet 1944, après la perte stratégique des îles Mariannes, la pression devient trop forte. L’empereur lui retire sa confiance, et Tojo est contraint de démissionner. Il reste conseiller militaire, mais perd l’essentiel de son influence. Il entre alors dans l’ombre, conscient que le destin du Japon est scellé.
Le procès d’un criminel de guerre
Après la capitulation du Japon, le 15 août 1945, les autorités américaines d’occupation, dirigées par le général MacArthur, ordonnent l’arrestation de Tojo. Le 11 septembre, alors que la police vient l’arrêter, il tente de se suicider d’une balle dans le cœur, mais survit miraculeusement. Il est soigné, puis conduit au tribunal de Tokyo.

US Army
Durant le procès de Tokyo (1946–1948), Tojo est accusé de crimes contre la paix, crimes de guerre, et crimes contre l’humanité. Il assume la responsabilité politique de la guerre, mais plaide l’obéissance à l’empereur et le devoir du soldat.
Le tribunal le juge coupable sur toute la ligne. Il est condamné à mort et exécuté par pendaison le 23 décembre 1948, avec six autres hauts responsables militaires. À la fin, il reste calme, se disant honoré d’avoir servi l’empereur.
Une figure controversée de l’histoire japonaise
Après sa mort, la mémoire de Tojo devient objet de tension et de controverse. Pour l’Occident, il demeure le visage du militarisme japonais, responsable de millions de morts. Mais au Japon, certains milieux nationalistes continuent de le vénérer comme un martyr, notamment au sanctuaire de Yasukuni, où son nom est inscrit parmi les « esprits divins ».
Hideki Tojo en quelques questions
Général de l’Armée impériale, Hideki Tōjō devient Premier ministre du Japon en octobre 1941. Surnommé « Kamisori » (Le Rasoir) pour sa rigueur administrative et son esprit tranchant, il cumule les postes de ministre de la Guerre et de l’Intérieur, exerçant un contrôle quasi total sur le pays durant la phase ascendante du conflit.
En tant que chef du gouvernement et leader de la faction belliciste, Tōjō est le principal architecte de l’entrée en guerre du Japon. Persuadé que les États-Unis finiraient par attaquer, il a convaincu l’état-major et l’Empereur qu’une frappe préventive était la seule option pour briser l’embargo qui asphyxiait l’industrie japonaise.
Bien qu’il ait exercé un pouvoir immense, Tōjō n’était pas un autocrate absolu. Il agissait toujours au nom de l’Empereur et devait composer avec l’état-major de la Marine et la bureaucratie impériale. Contrairement à Hitler, il fut contraint à la démission en 1944 après la perte de l’île de Saipan, preuve que son pouvoir restait révocable.
C’était le concept idéologique utilisé par Tōjō pour justifier l’expansionnisme japonais en Asie. Officiellement, il s’agissait de libérer les peuples asiatiques du colonialisme occidental. Dans les faits, cela s’est traduit par une exploitation brutale des ressources et des populations des pays occupés.
Après la capitulation du Japon en 1945, il tente de se suicider par balle au moment de son arrestation, mais il est sauvé par les médecins américains. Jugé par le Tribunal de Tokyo pour crimes de guerre, il assume l’entière responsabilité des actes du Japon. Il est condamné à mort et pendu le 23 décembre 1948.