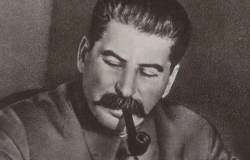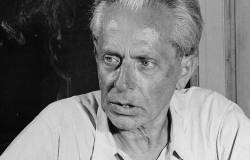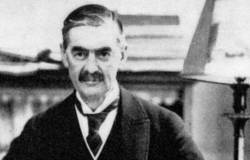Adolf Hitler
(1889–1945)


Une jeunesse errante et déjà radicalisée
Adolf Hitler naît le 20 avril 1889 à Braunau am Inn, une petite ville de l’Empire austro-hongrois, à la frontière de la Bavière. Il est le quatrième enfant d’un couple déjà endeuillé à plusieurs reprises. Son père, Alois Hitler, est un douanier sévère, autoritaire, souvent colérique, qui impose une discipline rigide à ses enfants. Il espère pour son fils un avenir dans l’administration. Sa mère, Klara Pölzl, est au contraire une femme douce, dévouée, effacée, qu’Adolf adore et idolâtre. Cette relation maternelle forte va profondément marquer sa vie.
Le drame de la perte de sa mère
Les relations entre Adolf et son père sont tendues. Alois veut faire de son fils un fonctionnaire. Cependant, le jeune Hitler, rêveur et rétif à l’autorité, aspire à devenir artiste. En 1903, son père meurt subitement d’une hémorragie pulmonaire, alors qu’Adolf a 13 ans. La perte ne l’affecte que modérément. En revanche, le décès de sa mère, Klara, en 1907, des suites d’un cancer du sein, le plonge dans un profond désespoir.
Orphelin, sans diplôme, Hitler s’installe à Vienne pour tenter sa chance à l’Académie des Beaux-Arts. Il échoue deux fois, et sombre dans la précarité. Dès lors, il vit dans des foyers pour hommes seuls, vend des aquarelles de monuments, survit comme il le peut. Néanmoins, cette période de misère est aussi celle où germe son idéologie. En effet, à Vienne, il s’abreuve des discours antisémites, pangermanistes et xénophobes qui pullulent dans une ville alors en pleine agitation nationaliste. Il développe une haine profonde des Juifs, des marxistes, des élites libérales, et rêve d’un État fort, pur, autoritaire.
La Première Guerre mondiale : creuset du fanatisme
Quand éclate la Première Guerre mondiale, Hitler s’engage volontairement dans l’armée allemande. Il sert comme messager sur le front de l’Ouest. Lors du conflit, il est blessé à deux reprises et décoré de la croix de fer, mais reste caporal. Ainsi, il n’accède jamais au grade d’officier, ce qui en dit long sur ses compétences militaires réelles et son absence de charisme parmi ses pairs.
La défaite de 1918 est pour lui un choc. Il est hospitalisé quand il apprend l’armistice, et voit dans la capitulation une trahison de l’intérieur. Hitler adhère totalement à la légende du « coup de poignard dans le dos », qui accuse les politiciens républicains, les socialistes et les Juifs d’avoir trahi une armée invaincue. Dès lors ce mythe alimentera toute sa vision du monde.
L’ascension politique : de Munich à Landsberg
Après la guerre, Hitler est recruté par l’armée pour surveiller les milieux politiques radicaux. C’est ainsi qu’il découvre le DAP, un groupuscule d’extrême droite, dont il devient rapidement le principal orateur. Rebaptisé NSDAP, le parti se développe rapidement dans le climat instable de la République de Weimar.
En 1923, grisé par l’exemple de Mussolini en Italie, Hitler tente un coup d’État à Munich. L’échec est total : le putsch est réprimé, seize militants nazis sont tués, et Hitler est arrêté. Toutefois, il profite de son procès pour se faire connaître nationalement. Il est condamné à cinq ans de prison (il en purge finalement moins d’un). C’est en prison qu’il rédige Mein Kampf (« Mon combat »), un manifeste mêlant autobiographie et programme politique. Il y expose ses idées : racisme biologique, antisémitisme obsessionnel, rejet de la démocratie, culte du chef, et expansion vers l’Est — le Lebensraum.

BPK, Berlin, Dist. RMN – Grand Palais -Heinrich Hoffmann
Crise économique et prise du pouvoir
À sa sortie de prison, Hitler comprend que la conquête du pouvoir devra passer par les institutions. Le NSDAP reste marginal jusqu’à la crise de 1929. En raison du krach de Wall Street, l’Allemagne plonge dans le chaos économique. Le chômage explose, les faillites se multiplient, les partis traditionnels s’effondrent. Hitler promet l’ordre, la grandeur retrouvée et la revanche sur Versailles. Son discours séduit les masses déçues et les élites conservatrices inquiètes du communisme.
En 1932, le NSDAP devient le premier parti du Reichstag. Au final, en janvier 1933, Hitler est nommé chancelier, alors qu’il n’est pas majoritaire au Parlement. En effet, les conservateurs pensent alors pouvoir s’appuyer sur lui, le contrôler et l’utiliser comme une marionnette. Mais Hitler n’a besoin que de quelques mois pour transformer la République en dictature. L’incendie du Reichstag, probablement déclenché par les siens, lui sert de prétexte pour instaurer un régime d’exception, réprimer les communistes, puis éliminer toute opposition politique. En août 1934, à la mort du Président Hindenburg, il se proclame Führer, chef absolu de l’Allemagne.
Dictature, propagande et réarmement
Le régime nazi repose sur trois piliers. D’abord, la terreur, exercée par la Gestapo et les SS. Ensuite, la propagande, orchestrée par Joseph Goebbels. Enfin, une politique sociale habile, qui redonne du travail grâce aux grands travaux et à la militarisation. Le chômage chute, les autoroutes se construisent, les jeunes sont embrigadés dans les Jeunesses hitlériennes. Mais tout cela prépare l’Allemagne à la guerre.

AP
Hitler viole les clauses du traité de Versailles en remilitarisant la Rhénanie en 1936, puis annexe l’Autriche en 1938 (Anschluss), et démembre ensuite la Tchécoslovaquie. Ce faisant, il teste la détermination des démocraties occidentales — et les trouve faibles, hésitantes, paralysées par la peur d’un nouveau conflit, ce qui le renforce.
Stratège autodidacte… et souvent désastreux
Contrairement à l’image qu’il cherche à se donner, Hitler n’est pas un grand stratège militaire. Il se méfie de ses généraux, les humilie, prend seul les décisions les plus critiques, souvent contre l’avis du haut commandement. Ainsi, il refuse les retraites, impose des offensives irréalistes, et commet des erreurs majeures qui coûteront cher à l’Allemagne.
Parmi les plus notables :
- L’attaque prématurée de l’Union soviétique en juin 1941, sans avoir écrasé le Royaume-Uni
- L’acharnement sur Stalingrad, symbole vide de valeur stratégique mais coûteux en hommes et matériel
- Le refus de céder un pouce de terrain, même lorsque la retraite tactique était vitale
Son arrogance stratégique devient un handicap majeur, particulièrement à partir de 1942.
Une cible de plus en plus isolée
À mesure que la guerre tourne à l’échec, Hitler devient la cible de plusieurs tentatives d’assassinat. Bien que celle du 20 juillet 1944, menée par Claus von Stauffenberg, soit la plus célèbre, plusieurs autres complots ont eu lieu auparavant. Il en réchappe à chaque fois, par hasard, ou à cause de la maladresse des comploteurs. Après l’attentat de juillet 1944, il ordonne une répression féroce : des centaines de personnes sont arrêtées, torturées, exécutées.

BPK, Berlin, Dist. RMN – Grand Palais – Heinrich Hoffmann
Isolé dans ses résidences, Hitler sombre dans la paranoïa, coupe les ponts avec la réalité, continue de donner des ordres délirants. Il place alors ses espoirs dans des armes miracles (missiles V2, chars surdimensionnés), qui pourtant ne changent rien à l’issue du conflit.
Le crépuscule du Führer
En avril 1945, Berlin est encerclée par l’Armée rouge. Hitler, retranché dans son bunker, ne dirige plus que par obsession. Il accuse le peuple allemand d’avoir failli à sa mission, et ordonne à son ministre Albert Speer la destruction des infrastructures du Reich, dans une logique d’autodestruction totale. Ordre qui ne sera d’ailleurs pas appliqué par Speer.
Le 30 avril 1945, après avoir épousé Eva Braun, il se suicide d’une balle dans la tête. Conformément à ses ordres, son corps est brûlé à l’extérieur du bunker, pour ne pas tomber entre les mains des soviétiques. Le régime nazi s’effondre dans les jours qui suivent. L’Europe, elle, sort exsangue de six années de guerre.
Adolf Hitler en quelques questions
Adolf Hitler est né le 20 avril 1889 à Braunau am Inn, une petite ville de l’Empire austro-hongrois située à la frontière de la Bavière.
Orphelin et sans diplôme, il a tenté par deux fois d’intégrer l’Académie des Beaux-Arts de Vienne, mais a échoué aux examens d’entrée. Cette période de précarité à Vienne a été le creuset de sa radicalisation idéologique et de son antisémitisme.
Il s’est engagé volontairement dans l’armée allemande comme messager sur le front de l’Ouest. Bien que décoré de la Croix de Fer, il n’a jamais dépassé le grade de caporal, un manque de progression qui illustre son absence de charisme initial parmi ses pairs.
Profitant du chaos économique de la crise de 1929, le NSDAP est devenu le premier parti du Reichstag. En janvier 1933, Hitler a été nommé chancelier par le président Hindenburg, les conservateurs pensant, à tort, pouvoir le contrôler.
Il s’agit de la tentative d’assassinat la plus célèbre contre Hitler, menée par Claus von Stauffenberg au Wolfsschanze. Hitler en a réchappé par miracle, ce qui a déclenché une répression féroce contre les comploteurs et les opposants internes.
Le 30 avril 1945, alors que Berlin est encerclée par l’Armée rouge, Adolf Hitler s’est suicidé d’une balle dans la tête dans son bunker (le Führerbunker). Son corps a été brûlé à l’extérieur, conformément à ses dernières instructions.